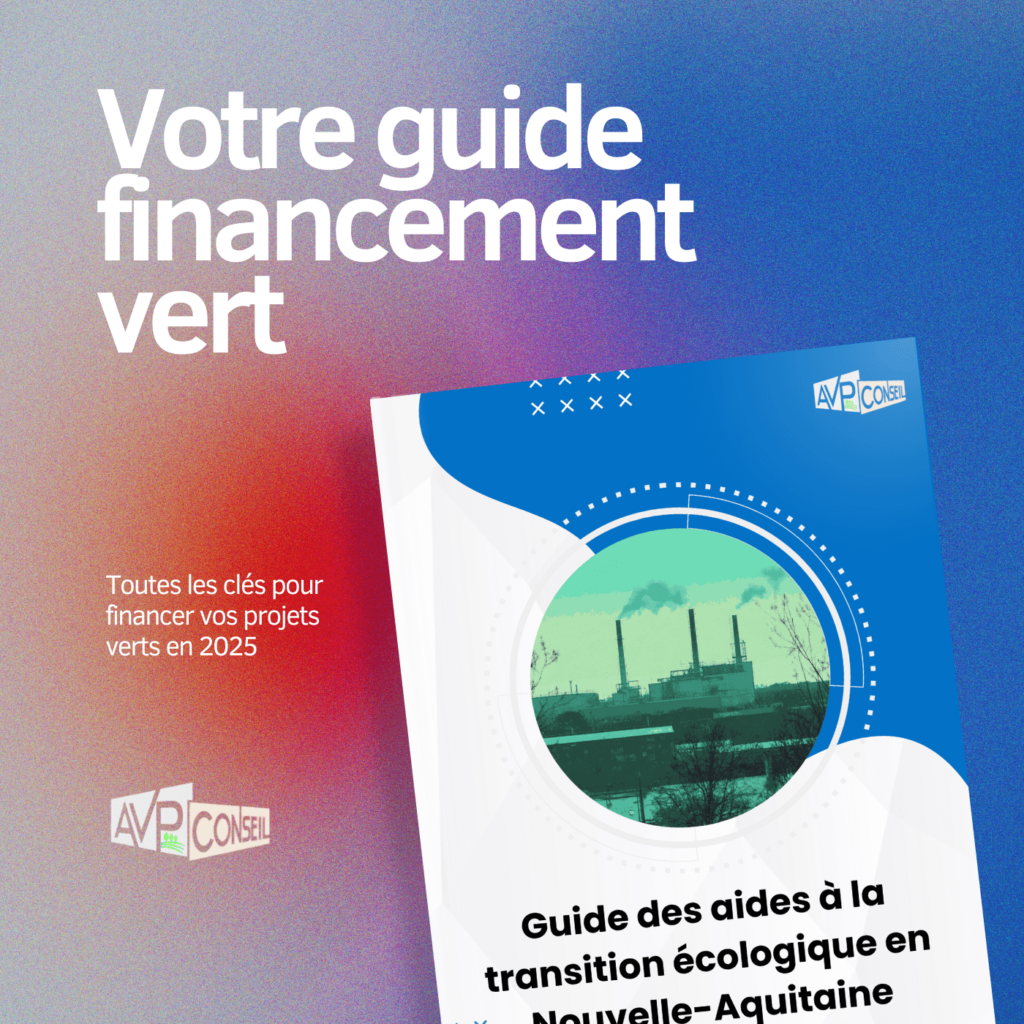La décroissance a le vent en poupe.
Face à l’échec des politiques climatiques traditionnelles, elle séduit par son radicalisme : réduire la production et la consommation pour alléger notre empreinte écologique.
Simple, logique, implacable.
Pourtant, appliquée au secteur industriel, cette solution présente certaines limites.
Car si l’idée de « ralentir » peut sembler séduisante dans un monde en surchauffe, elle repose sur une confusion fondamentale : croire que réduire l’activité économique est synonyme de réduction d’impact environnemental.
C’est oublier une réalité cruciale : certaines industries sont incontournables, non seulement pour notre mode de vie, mais aussi pour la transition écologique elle-même. Arrêter de produire ne règle pas le problème, il le déplace.
Prenons un exemple : les énergies renouvelables. Produire des éoliennes, des panneaux solaires, des batteries nécessite des métaux rares, une chaîne logistique mondiale et une industrie lourde. Si l’on applique une décroissance stricte, on freine aussi la production des outils nécessaires à la décarbonation. Résultat ? On se condamne à dépendre plus longtemps des énergies fossiles, avec un impact écologique bien pire.
L’enjeu n’est donc pas de choisir entre « croissance » et « décroissance », mais de transformer notre industrie pour la rendre compatible avec les limites planétaires.
Miser sur l’innovation technologique, l’écoconception et une régulation intelligente permettra bien plus de progrès que de chercher à ralentir un système sans le réinventer.
Alors, faut-il vraiment ralentir ? Ou bien faut-il changer de modèle, sans tomber dans les pièges dogmatiques ? C’est ce que nous allons voir ensemble.
1. La décroissance face à la réalité industrielle
La décroissance repose sur une idée centrale : réduire la production et la consommation permettrait mécaniquement d’alléger notre empreinte écologique. Sur le papier, l’argument semble imparable. Dans la réalité industrielle, il se heurte à un mur : les besoins matériels incompressibles et l’impossibilité d’une sobriété radicale dans certains secteurs stratégiques.
L’industrie ne peut pas simplement “ralentir”
Dans les discours décroissants, l’industrie est souvent décrite comme un monstre vorace en ressources qu’il suffirait de mettre au régime. Mais peut-on vraiment imaginer un monde sans production industrielle ? Sans acier, sans ciment, sans technologies avancées ? Même en réduisant drastiquement la consommation, certaines productions restent vitales :
- Les infrastructures essentielles (ponts, bâtiments, réseaux électriques) nécessitent des matériaux de base difficilement substituables.
- Les technologies de transition écologique (batteries, éoliennes, panneaux solaires) dépendent d’une industrie minière et manufacturière à forte intensité énergétique.
- La santé, l’agriculture, les transports reposent tous sur une base industrielle robuste.
Selon l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), la production mondiale de minéraux critiques pour la transition énergétique (lithium, cobalt, nickel) devra être multipliée par six d’ici 2040 pour respecter les objectifs climatiques. Une décroissance stricte mettrait donc en péril cette transformation.
Pourquoi une sobriété industrielle radicale est irréaliste
Certains secteurs industriels ont déjà optimisé leur efficacité énergétique à l’extrême. La sidérurgie, par exemple, a fait des efforts significatifs pour réduire ses émissions de CO₂ au fil des décennies grâce à des améliorations technologiques et des pratiques plus durables.
Imaginer une réduction brutale de la production pose trois problèmes majeurs :
- Les effets de chaîne : une baisse drastique de production industrielle affecte tous les secteurs en aval (construction, transports, énergies renouvelables).
- L’externalisation du problème : moins produire localement signifie souvent importer plus, et donc déplacer les émissions au lieu de les réduire.
- L’impact social : moins d’industrie, c’est moins d’emplois. En France, l’industrie représente 20 % des émissions de CO₂ mais aussi 3,3 millions d’emplois directs (Insee).
L’exemple des énergies renouvelables : un paradoxe décroissant
Un des arguments centraux de la décroissance est de limiter notre consommation d’énergie. Mais sans industrie, pas de transition énergétique. Une étude publiée dans Nature Communications (source) montre que la construction des infrastructures bas carbone (solaire, éolien, réseaux intelligents) nécessitera des investissements massifs et une augmentation temporaire de l’extraction de métaux rares.
Concrètement ? Si nous réduisons brutalement l’industrie lourde, nous risquons de ralentir la décarbonation au lieu de l’accélérer. Un paradoxe qui invalide l’idée d’une décroissance généralisée et non ciblée.
2. L’erreur de raisonnement : confondre réduction et transformation
Les défenseurs de la décroissance soutiennent que moins produire signifie automatiquement moins impacter l’environnement.
Mais cette vision simpliste passe à côté d’un point essentiel : ce n’est pas la quantité de production qui compte, mais la manière dont elle est réalisée.
Pourquoi réduire la production ne garantit pas une baisse des impacts écologiques
Prenons un exemple : l’industrie automobile. Un scénario décroissant prônerait une forte réduction du nombre de voitures produites, incitant à une utilisation plus raisonnée des véhicules existants.
À première vue, l’idée semble séduisante. Mais qu’arrive-t-il si les voitures restantes sont anciennes, polluantes et inefficaces ?
Une voiture thermique vieille de 15 ans émet en moyenne davantage de CO₂ qu’un véhicule récent aux normes Euro 6. Réduire la production de voitures sans renouveler le parc automobile peut donc ralentir la transition écologique plutôt que l’accélérer.
Le problème est similaire dans l’industrie énergétique :
- Fermer des centrales polluantes ? Oui, mais sans infrastructures de remplacement, on risque des pénuries énergétiques et un report sur des solutions fossiles (exemple récent en Allemagne avec le charbon après l’arrêt du nucléaire).
- Réduire l’extraction minière ? D’accord, mais comment produire des batteries et des panneaux solaires sans matières premières ?
Dire que « moins, c’est toujours mieux » est une erreur. La bonne approche, selon moi : Il s’agit de transformer nos modes de production pour faire mieux avec moins, plutôt que de simplement faire moins.
L’effet rebond : le piège invisible
Même lorsque la consommation de ressources diminue, les gains peuvent être annulés par un phénomène bien connu des économistes : l’effet rebond.
Dans les années 1970, les nouvelles chaudières domestiques ont permis une baisse de de la consommation d’énergie… mais la facture énergétique des ménages n’a que peu baissé car ils en ont profité pour chauffer davantage leurs maisons.
Dans l’industrie, c’est pareil :
- Une entreprise qui réduit sa consommation énergétique peut réinvestir l’argent économisé dans une production plus intensive.
- Une baisse de la production locale peut être compensée par des importations, annulant ainsi le bénéfice environnemental initial.
La décroissance face aux pays émergents : un modèle applicable uniquement aux pays riches ?
L’un des angles morts du discours décroissant est qu’il suppose un monde homogène. Or, la majorité des émissions futures viendront des pays émergents :
- En 2023, la Chine a émis 11,5 milliards de tonnes de CO₂, soit 30 % des émissions mondiales.
- L’Inde et l’Afrique connaissent une croissance industrielle rapide, alimentée par les énergies fossiles.
Si la décroissance est appliquée strictement en Europe, qui compensera cette réduction ailleurs ? Car pendant que les économies occidentales ralentiraient leur production, d’autres régions du monde pourraient prendre le relais avec des modèles bien plus polluants.
La décroissance est un luxe de pays riches qui ont déjà atteint un niveau de développement suffisant. Pour un pays en développement, réduire la production signifie freiner l’accès aux infrastructures de base, à l’éducation et à la santé.
3. Le pari technologique et organisationnel : une alternative crédible ?
Face aux limites de la décroissance, une question clé se pose : existe-t-il une alternative qui réduise réellement notre impact sans détruire le tissu industriel et économique ? La réponse est oui, et elle repose sur deux piliers : l’innovation technologique et la transformation organisationnelle.
Décarboner l’industrie : des solutions concrètes existent
Contrairement à ce que laissent entendre certains discours décroissants, des solutions technologiques existent déjà pour décarboner l’industrie. Elles ne sont pas des promesses lointaines, mais des innovations en cours de déploiement :
1️⃣ Captage et stockage du carbone (CCS) : cette technologie permet de capter le CO₂ à la source (centrales, usines sidérurgiques) et de le stocker sous terre. Selon l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), le CCS pourrait réduire jusqu’à 15 % des émissions mondiales d’ici 2050.
2️⃣ Électrification des procédés industriels : remplacer les procédés thermiques par des alternatives électriques bas carbone (four à arc pour l’acier, hydrogène vert pour la chimie) permettrait une réduction massive des émissions. Un rapport de McKinsey estime que l’électrification pourrait abattre 40 % des émissions industrielles d’ici 2050.
3️⃣ Économie circulaire et écoconception : produire autrement en réduisant le gaspillage de ressources et en intégrant des matériaux recyclés.
- Exemple : l’industrie du bâtiment adopte des bétons bas carbone et des techniques de réemploi des matériaux, réduisant de 30 à 50 % l’empreinte carbone de certaines constructions.
- Exemple : l’industrie textile pourrait diviser par trois son impact environnemental avec des modèles basés sur le recyclage et l’économie de la fonctionnalité (location plutôt qu’achat).
Ce que ça prouve : l’enjeu n’est pas de décroître, mais de réorienter la production industrielle vers des procédés plus soutenables.
L’innovation organisationnelle : un levier sous-estimé
L’autre facteur clé est l’optimisation des modèles de production et de consommation. Plutôt que de supprimer l’industrie, il s’agit de la rendre plus efficace et plus locale :
✅ Régionalisation des chaînes de valeur : relocaliser certaines productions stratégiques réduit les émissions liées aux transports et sécurise les approvisionnements.
- Exemple : l’Europe investit massivement pour relocaliser la production de batteries et éviter une dépendance excessive à la Chine.
✅ Modèle serviciel et allongement de la durée de vie des produits :
- Passer de la vente de produits à la location (ex : Rolls-Royce vend des heures de vol plutôt que des moteurs).
- Réparer plutôt que remplacer : le reconditionnement industriel se développe fortement (Apple, Tesla, fabricants d’équipements industriels).
✅ Tarification carbone et régulation intelligente :
- Taxe carbone progressive : rendre les industries polluantes plus coûteuses sans asphyxier l’économie.
- Systèmes de quotas d’émissions : inspirés des marchés carbone européens, ils permettent de fixer une trajectoire de décarbonation progressive et crédible.
On peut donc transformer l’industrie sans la saborder. Ce n’est pas en réduisant arbitrairement la production qu’on réglera le problème, mais en redéfinissant les règles du jeu économique.
4. Le vrai débat : quel modèle économique pour une industrie soutenable ?
Nous avons vu que la décroissance, appliquée à l’industrie, est un pari risqué et souvent contre-productif.
Nous avons aussi démontré que des solutions technologiques et organisationnelles existent pour réduire l’impact environnemental sans sacrifier la production.
Mais alors, quel modèle économique permettrait d’assurer cette transition de manière crédible et durable ?
La clé réside dans un concept qui dépasse l’opposition stérile entre croissance et décroissance : la croissance régénérative.
Vers une croissance régénérative : produire autrement plutôt que moins
Le principal problème de notre modèle économique actuel n’est pas la croissance en soi, mais le fait qu’elle repose sur une exploitation linéaire des ressources naturelles. Le schéma dominant est simple : extraire, produire, consommer, jeter.
Ce modèle doit disparaître, mais cela ne signifie pas que l’activité économique doit ralentir.
Il faut changer de logique :
✅ D’une économie extractive à une économie régénérative
Plutôt que de réduire aveuglément la production, il s’agit d’aligner la croissance économique sur les cycles naturels en intégrant des principes de régénération des ressources.
- Exemple : l’agriculture régénérative → plutôt que de se focaliser sur la réduction de l’agriculture intensive, des techniques comme l’agroforesterie et la rotation des cultures permettent d’améliorer la fertilité des sols tout en maintenant les rendements.
- Exemple : l’industrie textile circulaire 👕 → des entreprises comme Patagonia développent des vêtements conçus pour durer et être recyclés, réduisant ainsi leur empreinte tout en continuant à croître.
✅ Du “toujours plus” au “mieux avec moins”
L’idée n’est pas de produire moins, mais de produire mieux, en remplaçant la logique d’accumulation par une logique d’efficience et de sobriété ciblée.
- L’innovation technologique permet déjà de découpler croissance et empreinte environnementale : l’intensité carbone de l’économie européenne a baissé de 20 % en 20 ans, preuve que la croissance verte est possible.
- Les gains d’efficacité sont colossaux dans l’industrie : un produit bien conçu consomme moins de ressources, dure plus longtemps et peut être recyclé en fin de vie (économie circulaire).
La transition écologique ne passe pas par un ralentissement généralisé de l’économie, mais par une transformation profonde des modèles de production et de consommation.
Régulation et taxation carbone : des outils plus efficaces que la décroissance
Si l’objectif est de réduire l’impact écologique de l’industrie, la décroissance n’est pas le bon levier. En revanche, réguler intelligemment les marchés et donner un signal prix aux entreprises fonctionne déjà :
✅ Une taxation progressive du carbone
- Un prix du carbone suffisamment élevé incite les entreprises à réduire leurs émissions sans les forcer à baisser leur production.
- En Suède, où la taxe carbone atteint 130 €/tonne de CO₂, les émissions ont baissé de 27 % depuis 1990, sans nuire à la croissance économique.
✅ Un marché d’échange de quotas d’émissions efficace
- En Europe, le marché carbone ETS a permis une réduction des émissions industrielles de 40 % depuis 2005 en obligeant les entreprises à payer pour polluer.
- Plutôt que de dicter une réduction aveugle de la production, ces systèmes laissent l’innovation et l’économie faire le travail, en rendant la pollution économiquement non rentable.
Le problème n’est pas la production en soi, mais son coût environnemental non intégré. Une régulation bien pensée peut guider l’industrie vers un modèle soutenable sans casser l’économie.
L’industrie du futur : une production alignée avec les limites planétaires
Le vrai enjeu, c’est de créer une industrie compatible avec les limites de la planète. Plusieurs pistes existent :
✅ Écologie industrielle : mutualiser les flux d’énergie et de ressources entre entreprises (exemple de Kalundborg au Danemark, où les déchets d’une usine deviennent les matières premières d’une autre).
✅ Industrie 4.0 et digitalisation : l’optimisation des process grâce à l’IA et l’IoT permet des réductions d’émissions significatives sans perte de productivité.
✅ Modèle basé sur l’usage plutôt que la propriété : développer des services autour des produits (économie de la fonctionnalité) pour maximiser leur durée de vie et minimiser l’extraction de ressources.
Le futur de l’industrie n’est ni dans la décroissance, ni dans une croissance débridée, mais dans un équilibre basé sur la régénération et l’efficience.
Sortir du dogme pour avancer
Le débat entre croissance et décroissance est une impasse. Opposer ces deux visions nous empêche d’identifier les véritables leviers de transformation. L’industrie doit évoluer, mais croire qu’une réduction drastique de la production est la solution revient à ignorer la complexité des interdépendances économiques et environnementales.
👉 La décroissance appliquée à l’industrie est une illusion dangereuse :
- Réduire aveuglément la production peut freiner la transition énergétique en limitant la fabrication des infrastructures bas carbone.
- Une réduction brutale de l’activité industrielle risque de déplacer la pollution vers d’autres régions du monde plutôt que de la réduire globalement.
- Ce modèle est inapplicable aux pays émergents, où le développement industriel reste essentiel à l’amélioration des conditions de vie.
👉 Ce qui fonctionne vraiment, c’est la transformation de l’industrie :
- Décarboner les processus productifs grâce aux technologies existantes (captage carbone, électrification, hydrogène vert).
- Réorienter la production vers des modèles d’économie circulaire et d’efficacité énergétique.
- Réguler intelligemment avec des outils comme la taxation carbone et les marchés de quotas d’émissions, qui ont déjà fait leurs preuves.
L’urgence est claire : nous avons besoin d’une industrie alignée avec les limites planétaires, mais nous n’avons pas besoin d’un modèle économique qui bride inutilement l’innovation et le progrès. Ce qui doit disparaître, ce n’est pas l’industrie, mais son modèle linéaire et polluant.
💡 La vraie question n’est pas “faut-il ralentir ?”, mais “comment produire autrement ?”